Trac47
Rédigé par yalla castel - - Aucun commentaire


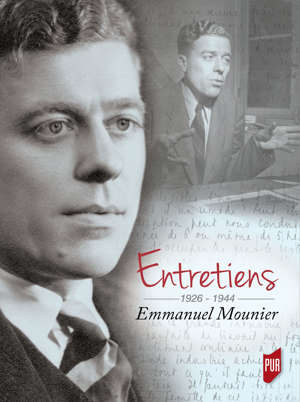


L'assemblée générale du CCFD Terre Solidaire du Lot-et-Garonne a eu lieu le vendredi 23 mai 2025 de 9h30 à 16h dans une salle paroissiale de Port Sainte Marie. Vingt-trois personnes y ont participé.
Le matin les différentes équipes départementales ont rappelé les actions menées en 2024 sur les territoires où elles sont présentes.Après un repas en commun sur le principe du panier partagé, l'après-midi a été consacrée à une réflexion collective sur les objectifs des actions à mener en 2025.Lors de cette assemblée générale Emmanuelle Guibert a tenu à remercier Christiane Barroux de son activité de trésorière pendant les huit ans qui viennent de s'écouler.Voici l'hommage qui lui a été rendu:"Pour toi Christiane, notre fidèle trésorière, qui a accepté de poursuivre son mandat jusqu'à que nous soyons à l'aise avec Kleemy et autres merveilles, des petits cadeaux pour te dire notre reconnaissance: celle du CCFD Terre Solidaire et la mienne qui a eu plaisir à travailler avec toi.
Pour toi qui aimes marcher en contemplant et en botaniste un guide : “La vie au fil des chemins”.Pour toi qui aimes cuisiner les bons fruits de la terre un guide: “L'ail à fermenter”.Et voici pour toi un peu d'huile de noisettes du Lot-et-Garonne, de la fleur de sel de Guérande accompagné du manuel de François Héritier “Le sel de la vie”, le tout pour profiter du moment présent.Pour toi qui aimes la solitude pour lire, peindre, visiter, marcher, ponctuée de moments d'amitié précieuse tu te retrouveras dans Erri de Luca. (1)Toi qui as dû regarder les cieux des Pyrénées, tu apprécieras le journal de Pierre Adrian (2), curé de la vallée d'Aspe pendant 50 ans “Une terre qui s'apprend par ses douleurs”, une vie d'âmes simples qui bousculent nos lassitudes et nous donnent de l'espérance, toi qui, comme nous tous, cherches Dieu.Voilà de quoi alimenter ton été avec du bon pain bio quotidien, du pain pour ton intelligence, du pain pour calmer ton coeur, du pain pour ta vie intérieure elle-même pétrie par l'esprit de celui qui nous unit.
Amitiés fraternelles, Emmanuelle.
(1) Erri de Luca: Après s'être engagé politiquement en 1968 et dans les luttes successives, il devient maçon. Tout en exerçant ce métier, il commence à publier des romans, des nouvelles et des exégèses bibliques. Et c'est justement dans la parole sacrée qu'il trouve les ressorts de son écriture, véritable recherche de valeurs absolues. (Une fois, un jour,1989 ; Un nuage comme tapis, 1991 ; Acide, arc-en-ciel, 1992 ; En haut, à gauche,1994 ; Alzaia, 1997 ; Tu, moi, 1998 ; Trois Chevaux, 1999 ; Montedidio, 2001).
Source : site internet du dictionnaire Larousse.
(2) Pierre Adrian est un écrivain français.Il a fait des études d'Histoire et de journalisme. “La piste Pasolini” obtient le Prix des Deux Magots 2016 et le prix François-Mauriac de l’Académie française.
Il publie, en 2017, "Des âmes simples". Ce roman reçoit le prix Roger-Nimier 2017.
Passionné de sport, notamment le cyclisme, il est entré depuis novembre 2016 comme chroniqueur dans le journal L'Équipe.
À 32 ans, Pierre Adrian a publié quatre livres salués par la critique et des prix littéraires. D’une écriture ciselée, travaillée, il raconte la vie dans ses moindres détails en laissant affleurer une quête de Dieu, tourmentée et absolue.
Source: Babélio