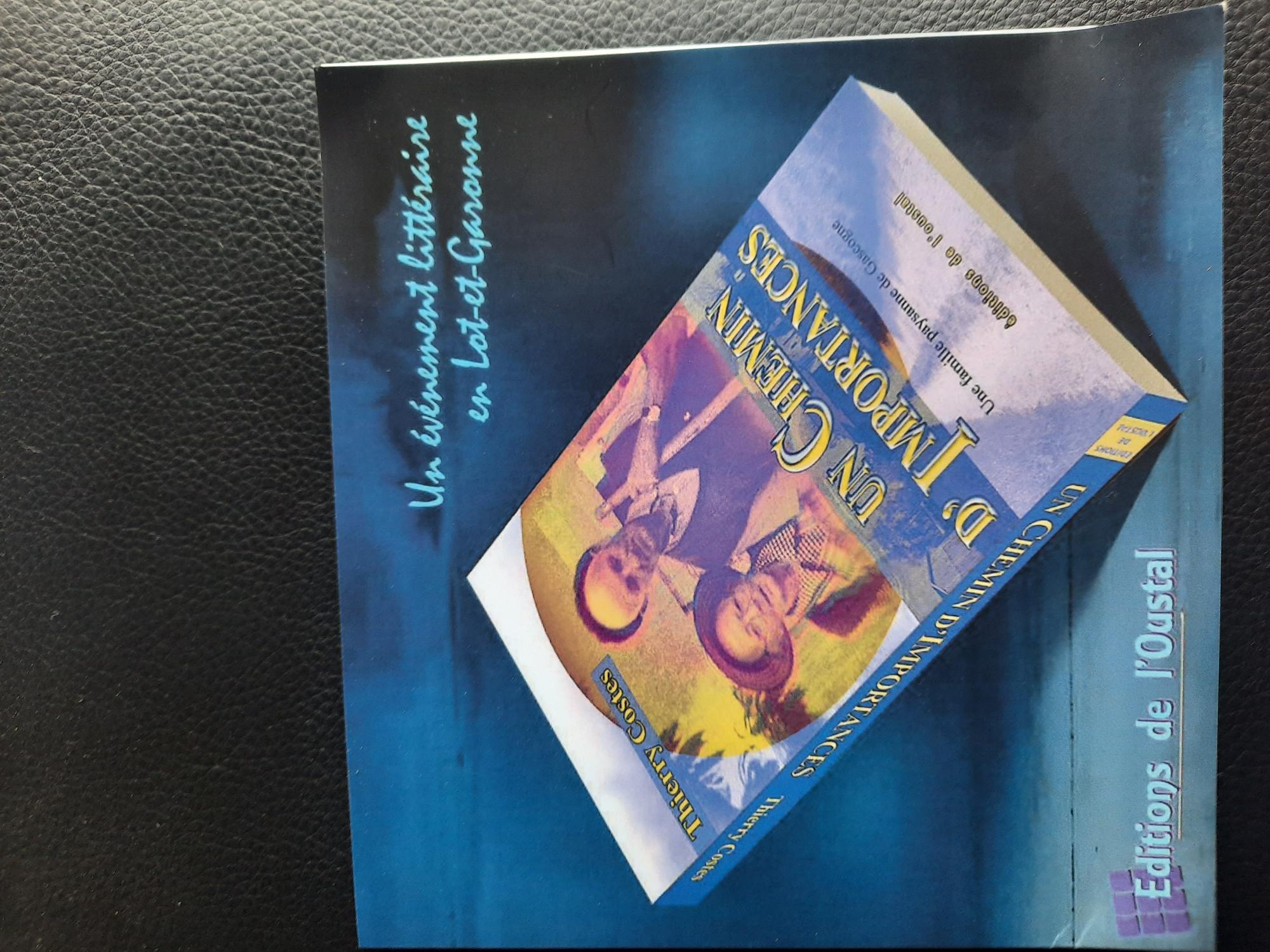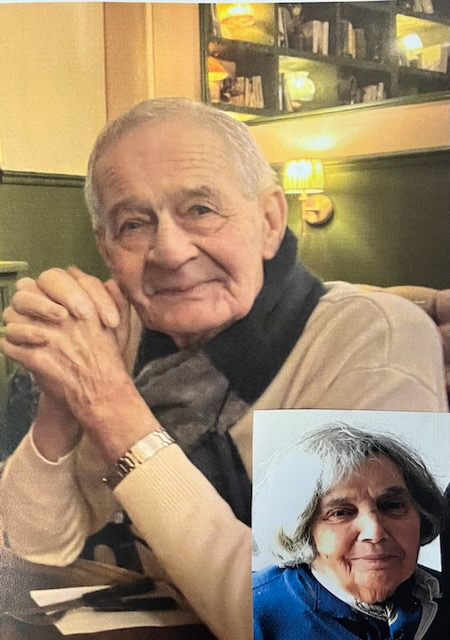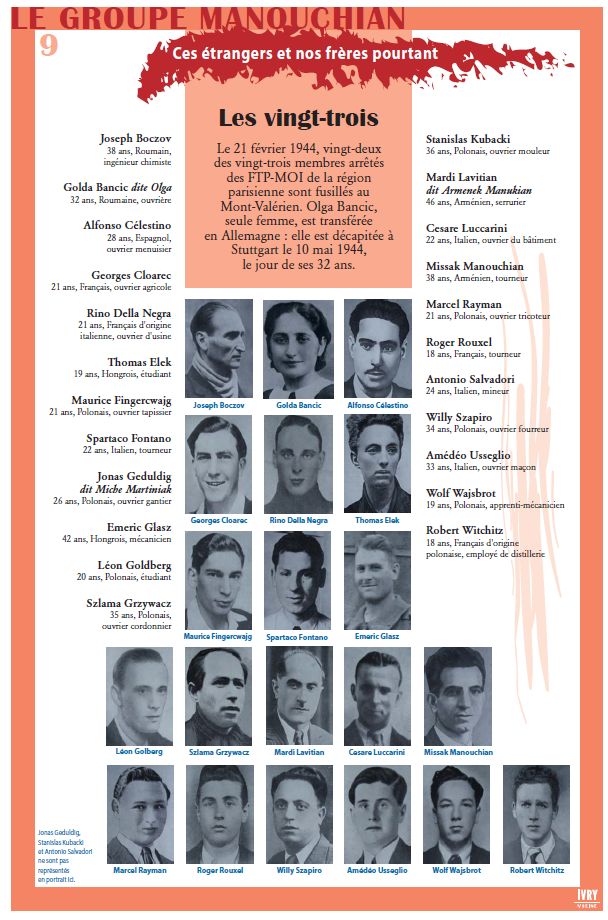En quoi la dépendance est-elle porteuse d'une des plus grandes libertés?
La liberté est dans la dépendance, voici un oxymore qui pourrait nous venir tout droit de la novlangue chère à Georges Orwell. Aussi farfelues et provocatrices que les expression bien connues dans son œuvre dystopique(1) 1984 : La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force.
La dépendance est-elle porteuse d'une des plus grandes libertés? Si, cette question qui évoque la contradiction d'un lieu commun, a mérite d'être posée, c'est que ces deux sujets, liberté et dépendance, provoquent le questionnement plus dans la recherche de leur sens que de leur définition.
Même s'il n'est pas question d'éviter de définir tour à tour liberté et dépendance – ce qui sera fait - l'objet de la réflexion sera d'être au plus précis du rapprochement de ces deux termes. Il y a des cheminements personnels qui font apparaître ce qui nous semblait autrefois intelligible, rationnel et naturel, comme des choses aujourd’hui, à décrypter, à nuancer, des choses qui auraient vieilli.
Quand je suis entré dans la carrière de la vie, celle où l'on commence à conceptualiser, j'aurais bien sûr dit : L'indépendance est porteuse d'une des plus grandes libertés. En jeune anarchiste, en quête de ce que je croyais être ma liberté, j'aurais enrôlé, l'autonomie, l'insoumission, l'indépendance. J'aurais combattu l'autorité, la servitude, la dépendance. Je ressentais trop aimer la vie pour perdre mon temps à attendre que le temps passe. Trop dans l'air du temps – ce que l'on pourrait appeler l'impérialisme du présent – pour envisager un seul instant une dépendance au temps.
Mais aujourd’hui, avec l'empirisme qui relativise les concepts trop évidents, quelques expériences et connaissances de phénomènes de dépendances me font envisager la liberté avec une plus grande indépendance de pensée.
En particulier, deux expériences vécues m'ont fait réfléchir à la dépendance et à la liberté et à ce que cette première apportait - bien loin de la restreindre - à la seconde.
Une expérience avec ma mère où j'ai assisté un moment de sa vie que l'on nomme la dépendance des personnes très âgées.
Une seconde expérience où j'ai vécu une passion affective, relation dans laquelle, se pose le rapport de la dépendance et de la liberté.
Donc si l'on veut démontrer l'aspect positif que la dépendance apporte à la liberté, il est nécessaire d'abord séparément de définir ces deux mots dépendance et liberté.
La dépendance est généralement, le fait d'être lié organiquement ou fonctionnellement à un ensemble ou à un élément d'un ensemble.
La dépendance, du moins en ce qui concerne son caractère (registre) relationnel, est défini par une relation de subordination, de solidarité ou de causalité.
La subordination n'est bien sûr pas l'aspect de la dépendance qui favoriserait le mieux la liberté. A moins que la subordination, comme la servitude, soit volontaire. Dans ce cas, quel est ce genre de liberté ?
La solidarité fait appel à l'union et ne s'oppose pas en soit à la liberté. 1
La causalité (2) ou Principe de causalité, est le principe suivant lequel rien n'est sans cause. Un tel principe ne semble pas s'opposer à la liberté.
La liberté, de façon générale, est un concept qui désigne les possibilités d'action, de mouvement, de décision, de penser.
3 formulations de la liberté nous la font cerner :
formulation négative : où l'on pointe l'absence de soumission, de servitude, de contrainte.
formulation positive : où l'on affirme l'autonomie et la spontanéité du sujet rationnel ; les comportements humains volontaires se fondent sur la liberté et sont qualifiés de libres.
formulation relative : l'équilibre à trouver dans une alternative, visant notamment à rendre la liberté compatible avec des principes tels que l'égalité et la justice.
La liberté, se sentir libre, c'est toujours ou souvent de l'interdépendance entre moi et l'autre, entre moi et les objets de mes désirs. Comme quoi, on ne peut éprouver la liberté qu'en rapport avec la dépendance qu'on éprouve. Si nous faisons ce que nous voulons, sans dépendance, notre liberté est avant tout une licence. La licence comme la manifestation de la liberté totale que l'on se donnerait dans une indépendance totale de notre être. La licence que nous demandons à l'autre, à l'institution, comme le diplôme du même nom – qu'il soit universitaire ou pour pour vendre de l'alcool, n'est pas la liberté. C'est au plus un marchandage que nous commerçons dans notre besoin de reconnaissance.
La liberté, Sartre nous l'a expliqué, est tout autre chose. Elle a besoin de résistance pour s'affirmer. Elle consiste à consentir à des règles qui vont permettre d'agir délibérément en vue de réaliser un projet. La liberté est une action intentionnelle qui pose un choix créateur.
La liberté pose donc immédiatement la question de choisir et de la possibilité de choix. L'existence d'un degré de liberté suppose que le sujet soit confronté au moins à une alternative dont il est par conséquent dépendant.
Pour revenir au deux cas exemple précédemment évoqués, en quoi la dépendance a-t-elle apporté de la liberté dans mes expériences vécues?
Quand je me suis occupé de ma mère, les trois dernières années de sa vie, elle vivait dans ce qu'on appelle la dépendance. Aveugle, infirme de ses mouvements, clouée dans sa maison puis dans sa chambre. Assistée trois fois par jour par une auxiliaire de vie salariée. Pour ma part, j'allais la visiter presque une fois par semaine et restais avec elle une journée. Je la voyais donc dans cet état de dépendance dont il était peu probable qu'il s'améliore. Elle, devait bien avoir conscience que cet état serait le sien jusqu'au bout.
Alors deux questions m'ont été posées. Comme se faisait-il que dans cet état dépendant, cette femme respirait la plupart du temps la joie comme je ne l'avais jamais vue, et avait quitté presque définitivement son tempérament dépressif et son comportement vindicatif.
Comment se faisait-il que dans ma propre dépendance d'être obligé, par devoir, de passer du temps de présence avec elle, j'ai pu réaliser enfin de ce qui avait été la joie de l'avoir eu comme mère. De par cette dépendance de présence, d'avoir pu éprouver de cette réconciliation intérieure de par ce qui avait été toujours problématique et peine de ma relation avec elle.
Comme si de cette dépendance était née une liberté de reconnaissance. Comme si le temps de cette dépendance avait apporté le temps nécessaire à la liberté de se sentir vivre, pour ne pas dire de revivre.
Dans le deuxième exemple où j'ai rencontré l'apparente contradiction entre dépendance et liberté, il s'agit d'une relation entre pairs, que l'on peut qualifier de relation affective intense et suivie. Qu'elle soit amoureuse ou d'amitié, la question du comment cette affection, cette passion a pu me rendre libre.
La dépendance, ici est de l'ordre de l'affection, comme quand deux personnes sont affectés à faire couple, dont l'affectation est l'union. Comme un couple qui a fait le choix de la fidélité dans le temps, comme la privation de la liberté d'aller voir ailleurs. Comme le couple qui fabrique par attirance, par affinité, cette grande dépendance que l'on nomme fusion. Cette dépendance, par lequel l'un est assujetti à l'autre. Ou symboliquement, il y a par moment comme une confusion des sujets.
Dans ce cadre rassurant – du moins tant qu'il est solide – ces deux qui s'aiment – on peut appeler ça comme ça – ces deux, gagnent une certaine liberté. Liberté de se mouvoir en confiance, puisque la relation établie, ils peuvent s'y fier. Dans cette dépendance encadrée, dans les limites fixées, donc qui ne bougent pas, les deux jouissent d'une des plus grandes libertés.
Dans le relationnel, l'humain ne cherche-t-il pas la dépendance bien avant la liberté. Ne passe-t-il pas dans les étapes de la vie, de la naissance, dépendance originelle et totale, à la mort, liberté suprême et totale. En quelque sorte, de la dépendance nécessaire pour acquérir une liberté suffisante.
Dans notre société, que cela soit au niveau individuel ou du modèle social, la dépendance n'a pas bonne presse. La personne autonome y est vantée, comme le sommet de l'accès à la liberté. La dépendance y est honni, comme l'image de la faiblesse, de celle qu'il faut cacher, si ce n'est éradiquer. Et c'est alors que l'on peut se demander par où est passée la liberté et comment elle nous touche et comment la toucher. Comme de cette strophe du fameux poème Liberté de Paul Eluard .
Sur l'absence sans désir Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort J'écris ton nom
Liberté
ou la chanson de Moustaki
Ma liberté
Devant tes volontés Mon âme était soumise
Serge Durrieux
(1) dystopique, aussi mauvais, désespérant, qu'une chose, une société puisse être.
(2) La causalité a pour premier terme la cause, c'est-à-dire la nécessité pour chaque partie d'être, par le fait de ce qui est hors d'elle, autre qu'elle ne serait si elle était seule.