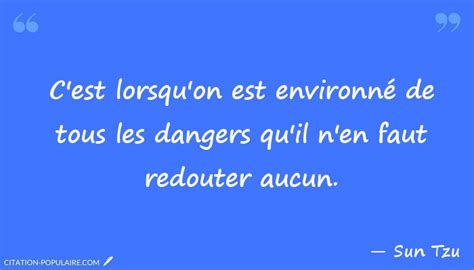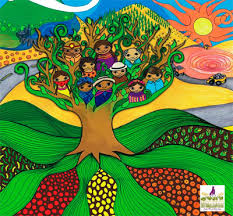L’assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, et sa cause, les dessins de Charlie Hebdo republiés, confirment ce qui apparaissait déjà lors de la tentative de meurtres du 25 septembre :
► Lutter réellement (radicalement) contre l’islamisme exigerait une double tâche politico-culturelle : 1. mettre au jour les vraies raisons françaises de relever le défi islamiste ; 2. amener les musulmans de France à modifier, dans l’islam, tout ce qui semble autoriser l’islamisme actuel.
► Ce point 2 exige que l’autorité “républicaine” n’ait pas l’air de combattre la religion musulmane en elle-même. Il exige aussi d’être mené en connaissance de cause : comment intervenir auprès de musulmans si l’on ne comprend pas leur religion ? ni d’ailleurs aucune religion…
► Or les dessins de Charlie Hebdo sont ignares au sujet de toutes les religions (conchiées stupidement par ce journal depuis des années). Ils prennent la forme d’outrages. Rappelons que le dessin montré aux élèves par le malheureux prof d’histoire-géo de Conflans et qui a déclenché d’abord la fureur de parents d’élèves (puis l’intrusion homicide du “jeune réfugié tchétchène” Abdoullah Abouyezidvitch), représentait Mahomet nu et accroupi, une étoile peinte sur la fesse, avec cette légende : “Une étoile est née” 1. Cette insulte inepte fait partie de ce que M. Macron présente comme “la liberté de ne pas croire”.
► Au lieu du combat politico-culturel qu’il faudrait mener contre l’islamisme, l’Etat a en effet choisi l’inepte : sacraliser Charlie Hebdo, et faire entrer ses dessins anti-Mahomet (mais très cons) dans les programmes des lycées et collèges – avec les conséquences que l’on sait. C’est une erreur contre-productive ; on n’a pas fini d’en subir les conséquences.
► Dire ces vérités sur le rôle de Charlie Hebdo et le vide mental des pouvoirs publics, ce n’est en aucun cas “se coucher devant les islamistes” comme le clament nos excités. Au contraire, c’est vouloir donner au combat contre l’islamisme un contenu adéquat : autre chose que ce que l’on appelle maintenant “valeurs de la République” et qui réside surtout dans les “avancées sociétales” venues des USA, qui scandalisent jusqu’à l’os les musulmans pieux. Du coup, ceux-ci se sentent coincés entre le marteau (une phobie antireligieuse présentée comme “française”) et l’enclume (l’islamisme importé d’ailleurs).
► Le président de la République devrait savoir que son “ils-ne-passeront-pas” d’hier soir est historiquement le cri d’une défaite : celle de la République espagnole, vaincue parce qu’elle ne se donna pas les moyens d’empêcher les franquistes de “passer”… Ne pas prendre les moyens aujourd’hui, c’est se tromper de terrain dans la lutte contre l’islamisme ; c’est prendre Charlie Hebdo comme phare intellectuel et moral ; c’est choquer et re-choquer les musulmans en donnant le label RF à de mauvaises caricatures ; c’est donc favoriser la stratégie d’islamistes dont le seul but est de prendre en main les musulmans français.
► Plutôt que d’aider stupidement l’ennemi en refusant de comprendre quel type de guerre il nous fait, mieux vaudrait le combattre intelligemment, donc efficacement. Si l’on veut “faire nation” contre lui, comme dit M. Macron, on ne le fera pas avec des idéaux fumeux et de la haine contre toutes les religions. Assez de grands mots et de petits dessins !
1. Allusion absurde au film de Wellman A star is born (1937) : on est cinéphile, à Charlie.
Source:
http://plunkett.hautetfort.com/archive/2020/10/17/apres-l-atrocite-de-conflans-quelques-suggestions-6270564.html?fbclid=IwAR3UAVeO10XMcTPbGf-5pxrieUqt8t54JNnt-ONqidoDKT6Qwpz-5kpR_E8
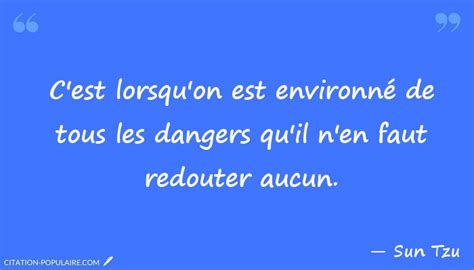
Lu ce matin sur Facebook une réaction d’enseignant probablement:
1/ Ce n’est pas la République qui a été attaquée, c’est un homme. Un homme avec un nom, Samuel Paty, un homme de 47 ans, père de famille, fonctionnaire. Qu’à travers ce meurtre, les valeurs de la République soient remises en cause, nul n’en doute. Mais brandir immédiatement l’étendard de la République est une manière, pour le président et ses sbires, d’occulter la triste réalité de notre métier, de ne pas la nommer, bref, de commencer à dissimuler la poussière sous le tapis des grandes phrases creuses. En passant au passage pour de grands démocrates rassembleurs, eux qui ne cessent de diviser les Français depuis 3 ans.
2/ Samuel Paty n’est pas mort « d’avoir défendu la liberté d’expression ». Il est mort d’avoir fait son travail (comme Arnaud Beltrame et d’autres), d’avoir appliqué des programmes scolaires, d’avoir été seul devant une classe et la vindicte de parents d’élèves malfaisants. Affirmer qu’il défendait la liberté d’expression est une exagération qui, encore une fois, ne sert qu’à masquer une réalité que l’on ne veut pas voir. Cela fait aussi de lui un militant, et de là à dire qu’il a donc un peu cherché ce qui lui est arrivé, il n’y a qu’un pas que certains ont déjà franchi allègrement.
3/ Entendre Blanquer parler de la liberté d’expression, c’est un peu comme entendre Michel Fourniret parler d’amour. La liberté d’expression si chère au ministre qui a fait la loi sur l’école de la confiance (nom orwellien qui aurait dû alerter…) dont l’article 1 n’a qu’un seul objectif : empêcher les enseignants de s’exprimer, y compris dans la sphère privée, quand ils sont des citoyens lambda. La liberté d’expression qui conduit cette administration à harceler et sanctionner les professeurs exerçant leur droit de grève (cf les 3 de Melle, parmi d’autres). La liberté d’expression qui permet à ce ministre de qualifier des enseignants en grève de « radicalisés » (dans le contexte des dernières années, il fallait oser…) et de participer à un bashing infondé en parlant de professeurs « décrocheurs » après le confinement, sans amener le moindre chiffre, la moindre preuve. La liberté d’expression, encore, quand les collègues de Christine Renon sont interdits de manquer une demi-journée de travail pour aller à ses obsèques et sont interdits de parler à la presse et de lui communiquer sa lettre d’adieu. La liberté d’expression, toujours, quand tout est fait pour étouffer le suicide de Jean Willot et de dizaines d’autres enseignants ces dernières années. La liberté d’expression, enfin, qui conduit le ministre, dans un réflexe pavlovien et avant toute enquête, à faire savoir ce dimanche « que l’Éducation nationale a eu une “réaction appropriée” dans cette affaire ».
4/ Les grands discours de ces deux derniers jours sont particulièrement écœurants car l’on sait pertinemment qu’ils ne seront suivis d’aucun acte. Il n’y aura ni remise en cause des politiques menées (ou de l’absence de politiques menées), ni mesures prises au sein de l’Éducation nationale. Nos décideurs politiques continueront leur petite existence déconnectée en tapinant auprès des communautaristes, l’Éducation nationale poursuivra son petit fonctionnement vichyste en promouvant les médiocres, les aigris et les Papons. Et le nom de Samuel Paty rejoindra dans l’oubli ceux d’Aurélie Châtelain, de Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, du père Hamel, d’Hervé Cornara et de tant d’autres.
5/ Je suis atterré par certains propos tenus sur des pages d’enseignants. Comment exprimer mon mépris aux collègues qui disent que Samuel Paty aurait dû choisir d’autres supports pour son cours (alors que les programmes indiquent l’exemple des caricatures de Charlie Hebdo), qu’il a jeté inconsidérément de l’huile sur le feu, etc. Autant de propos qui font de la victime le responsable. Hé ! Faut pas t’étonner de te faire siffler dans la rue si tu portes une jupe ! Mais c’est le résultat de 20 ans – a minima – de culpabilisation des enseignants, culpabilisation tellement intériorisée et assimilée par nombre de collègues qu’ils ne peuvent plus penser autrement. On transforme des problèmes politiques et sociétaux en problèmes pédagogiques, faisant ainsi du professeur le coupable : si tes élèves réagissent mal, c’est que tu t’y es mal pris. Il est vrai qu’un élève ne subit pas d’autres influences que l’école, qu’il ne regarde jamais les médias, qu’il n’a pas de parents, pas d’amis, etc.
6/ La promptitude du président et de son politburo d’analphabètes à qualifier le meurtrier de terroriste me laisse songeur. Fut une époque où l’acte terroriste était défini par la justice, après une enquête qui établissait que l’acte était planifié et que le terroriste avait été endoctriné, entraîné, financé, ou que sais-je. Pour l’heure, nous ne savons quasiment rien sur l’assassin. Peut-être est-ce un terroriste, agissant sur l’ordre d’une organisation. Peut-être est-ce juste un connard mégalomane de 18 ans avec de la bouillie à la place du cerveau qui s’est pris pour Daech à lui tout seul. Bref, un dément. Ce qui est certain, c’est que dans les deux cas il peut être reconnaissant à nos politiques et médias de le qualifier de terroriste, le terme donnant une aura et une justification politique à son geste. Et tant pis si ça suscite des vocations. Après tout, la France ne manque pas de fonctionnaires et d’innocents à assassiner.